« Appréciation du 7 novembre 41 »
Inédit de Maxime NEMO
Staline préféra rester à Moscou et décida d'organiser un défilé militaire sur la place Rouge le 7 novembre, pour le 24e anniversaire de la révolution bolchévique d’octobre 1917, et fait un discours et ce, malgré les risques de bombardement. Staline voulait montrer au monde entier que l'URSS tient et que les Soviétiques ne sont pas encore vaincus. Les Russes passèrent à notre calendrier grégorien.
http://www.northstarcompass.org/french/nscfr24/stalin.htm (Discours de Staline)
La politique se situe exactement aux antipodes de la métaphysique. En métaphysique, seule, la rigueur de l’idée fonde la vérité puis la maintient, au besoin contre l’évidence des faits ; en politique, il n’y a que les faits qui comptent. C’est pourquoi une « idée» politique peut devenir une si mesquine chose, en ce sens qu’elle ne tient aucun compte de la réalité que la politique a, précisément, pour fonction de régir. Ceci nous explique que les idéologues soient parmi les plus pauvres réalisateurs politiques qu’on puisse voir. Ne pas tenir compte des faits acquis ou prévisibles, en politique, est, non seulement une erreur mais la pire des imbécilités. Nos politiciens de droite ou de gauche, ne sont que d’irrespectables ganaches, car sans être le moins du monde métaphysiciens – ce qui serait tout de même une excuse majeure ! –ils méconnaissent la réalité et estiment ne devoir guider les faits du monde que selon l’ordonnance, aussi irrespectable qu’ils sont eux-mêmes, des quelques idées, sur lesquelles se fondent leur appréciation du réel ;
C’est pourquoi en politique, changer n’est pas un méfait, si le changement a pour base une réalité plus grande ou plus nettement perçue que celle qui nous avait fait prendre position auparavant.
Il y a à peu près quatre mois et demi que la guerre germano-russe a commencé. Aucune des hypothèses que j’envisageais comme possible le 22 juin dernier ne s’est visiblement réalisée. Une seule chose se confirme cependant. Je demandais si le technicien russe tiendrait en présence de la technique allemande, et je doutais que cela fut possible. Or, si ce technicien vaut plus que le nôtre, ce qui n’est qu’un piètre éloge, il est loin de valoir son « collègue » allemand. Les armées russes reculent sans cesse et semblent « fondre dans la fournaise ». Il est probable qu’en retour, l’armée allemande est sérieusement touchée par la résistance de l’adversaire qui, tout en se dérobant à l’étreinte, oppose une défense farouche. La guerre dure donc plus qu’il n’était possible de prévoir qu’elle durerait, il y a quatre mois. Mais ce n’est pas le seul aspect qu’il convient de reconsidérer ; c’est l’hypothèse de cette guerre « étrange» elle aussi qu’il convient de revoir et après 20 semaines d’hostilités, on peut encore dire quelle fut la cause initiale du conflit.
Depuis ce matin du 7 novembre 41 des hypothèses nouvelles ont effleuré mon esprit. Encore une fois, l’avenir dira si elle sont exactes.
Il faut en effet noter combien il est difficile de se former une opinion valable : nous vivons dans un vrai désert. Les informations d’où qu’elles se produisent sont suspectes autant que contradictoires et la meilleure méthode est, sans doute, de commencer par n’en pas tenir compte. Mais, alors, où est la réalité sur laquelle baser un jugement sain ? Il s’agit rien moins que de créer la perception de l’événement à l’aide des seules clartés intuitives. Par une sorte de génie généralisateur, il faut pénétrer dans le secret des faits accomplis, mais dont on sait seulement qu’ils le sont. On ne sait pas la cause qui les a provoqués ; ils sont encore un peu de la respiration du monde et vivent donc, à l’état de souffles. Dépourvus de la moindre plasticité, ces faits qui composent la réalité temporaire, il faut essayer de les deviner. Et l’esprit tremble un peu, l’appréhension de l’erreur restant considérable. Pourtant, à l’homme isolé que je suis, homme de bonne volonté s’il en est ! il faut accomplir cet effort.
C’est donc cette guerre, depuis son prodrome jusqu’à ses réalisations multiples qu’il convient de repenser, en essayant de ne pas s’égarer dans le labyrinthe des possibilités ou des cancans. C’est même bien plus que cela, c’est l’âme de cette guerre qu’il faut aborder en partant de son isolement personnel et de l’ignorance où je suis des faits qui se sont créés depuis deux ans. Je ne possède, en effet, que les renseignements de l’homme de la rue. Seuls peut-être changent, le moyen de les scruter pour établir leur figure possible, dans le réel.
L’âme de cette guerre n’est autre que l’âme d’Hitler. Je ne veux pas dire ici, que sa conscience a nettement prévu le conflit et l’avait accepté avant qu’il n’éclatât. Je suis à peu près certain que rien, en lui-même, n’a été si précis, et qu’en son âme et conscience, il a désiré ainsi qu’il l’a souvent affirmé, une solution possible sans que la guerre en soit la conséquence. Mais il en est de nos états d’esprit comme de bien des choses : ils portent, inconsciemment un destin en eux, et, ce destin se réalise contre leur sentiment au besoin. Le destin de l’état d’âme d’Hitler était de provoquer ce sanglant conflit. La guerre, dirai-je encore est la conséquence obligatoire de son propre rayonnement, de la création de ses divers états de sub-conscience.
Il est en ceci, bien différent de Mussolini ; d’ailleurs il s’oppose en tout au chef latin. Le rayonnement de ce dernier est limité par la précision de son rationalisme romain, tandis que celui d’Hitler est accru par la qualité de son essence germanique. Jamais chez Mussolini, la notion de l’action à entreprendre n’adopte une forme religieuse. ; tout en Hitler demande à atteindre cette forme et cette fonction. Pour cette raison, il est probable que l’arrivée d’Hitler et du nazisme allemand a sauvé le fascisme d’une désagrégation certaine, puisque, d’une normalisation déjà acquise. Il suffisait de se promener librement à travers l’Italie, à la veille de la guerre, pour sentir à quel point la vivacité fasciste se trouvait édulcorée.
D’ailleurs, je crois de plus en plus à une éclipse, au moins momentanée de l’influence méditerranéenne, pour la simple raison que la civilisation occidentale ne se sauvera du péril immense qui la menace – et qui est le plus grand qu’elle ait connu depuis 2000 ans !- que par un recours à la vie de l’esprit replié sur soi et sur ses valeurs. Or, cette intensité, le Nord nous l’apporte tout naturellement. C’est lui qui a créé la civilisation gothique, le mouvement du Protestantisme et une immense partie de la renaissance. Le Nord nous apporte-t-il une énième fois le salut, comme il nous l’apporta à l’aube et à la fin du Moyen Age et au moment de la renaissance ? je l’ignore, tout en indiquant la nécessité d’un tel mouvement d’opinion profonde. Je serais surpris qu’il n’y ait pas en Allemagne, à l’heure présente, un certain nombre de bons esprits pensant ainsi que moi ; en Allemagne et, peut-être en Scandinavie également.
La vie de l’âme chez Hitler rendait indispensable une évolution de l’homme qu’il est également et que je caractériserai ainsi : homme entraineur d’événements considérables. Il est de ces êtres, comme napoléon qui s’accomplissent dans l’événement collectif exactement comme l’artiste se trouve et se découvre dans et par son œuvre. Une fatalité emporte ces êtres, plus grande que leur intelligence, perçue et exprimée. Cela, c'est-à-dire, cet entraînement de l’œuvre créée, cet appel d’une proportion appelant une autre proportion, amène dans leur existence des éléments discordants qui peuvent être considérés comme autant de contradictions. En réalité, et comme toute nature puissante, la leur est d’une constante unité. Notre critique a constaté de ces contradictions dans le tempérament d’Hitler, contradictions que nous avons pris pour des mensonges volontaires. Une étude plus attentive de sa nature profonde permettrait peut-être d’éviter au moins ce terme et de mieux comprendre l’homme, puisque nous le jugerions à travers les difficultés qu’il a rencontrées et qu’il n’a vaincues qu’une à une.
Il existe dans toute création, une part immense de « fortune ». L’esprit, peut dès le début, en pressentir la présence confuse et compter sur cet apport, comme au jeu, on compte sur une chance ; mais le propre de l’émotion raisonnable est de s’opposer à l’apparition de ce hasard car elle ne peut accepter de hasard sans se nier tout entière. Toute imprévisibilité semble absurde à l’esprit qui raisonne et qui mesure. Or, cet esprit, Hitler ne l’a qu’en second lieu, étant avant tout passionné.
Et, ici, il serait mesquin de refuser à cet homme la reconnaissance de sa qualité essentielle : il a la passion de l’Allemagne. A cette ardeur patriotique, que nul Français digne de ce nom, n’a le droit de contester au maître du Reich, s’ajoute une passion morale qui, pour être moins apparent, est également certaine. C’est cette passion, autre que la première, qui le moment venu, exige que l’homme patriote dépasse les limites du sens national pour l’amener à généraliser sa pensée et à étendre sa volonté dans une affirmation de plus en plus considérable et aussi de moins en moins concrète.
Evidemment un grand échec ferait rentrer dans l’ombre, la partie la plus dense, la plus ardente de ces « rêves » et en particulier de l’homme d’état qui est, en même temps, un rêveur, et ces volontés qui ne sont d’abord que des velléités, parce que des volontés, pas encore certaines de ce que je nommerai : leurs débouchés avorteraient sans doute. Mais c’est l’étrange destin de ces hommes : il forcent les Destin à les accomplir, comme s’ils étaient des complices du Destin.
Napoléon trouvant l’égal de César ou d’Alexandre en face de lui eût probablement fini sa vie dans la peau d’un obscur général de la première République ; de même, si Hitler avait rencontré une volonté égale en génie comme en persévérance à la sienne, son échec aurait été probable. Au contraire, en présence de sa dimension, il trouve les polichinelles anglais ou américains, ou les fantoches français. Déjà sur le plan intérieur il a « avalé » tous les politiciens weimariens, simple pacotille dont son regard discernait la piètre qualité.
Il agit, mais, nécessairement, il procède par bonds successifs, dominant ces opposants successifs et diluant leur antagonisme, comme on fait fondre des pilules dans la bouche. Et c’est ainsi qu’il évince ses chefs de partis populaires dont on n’entendra plus jamais parler, comme il évince les Hohenzollern, les hobereaux poméraniens ainsi que les partis populaires puissamment organisés de l’Allemagne moderne : Sozial Democratie, Communistes, centre catholique etc…. Et naturellement, sa confiance en lui grandit et sa foi en lui-même, et, en lui seul se fortifie à chaque victoire. Et c’est aussi pourquoi un résultat atteint lui procure l’idée d’un autre résultat et qu’il dépasse les points qu’il s’était assignée d’abord comme limite ; exactement comme une œuvre terminée est pour l’artiste une excitation en vue d’une nouvelle création ; l’artiste se trouvant, avec l’œuvre achevée en présence d’un vide que sa nature créatrice ne peut tolérer.
Le monde qui ne comprend pas laisse cet homme prendre conscience de lui et de sa force. Ce monde des réalistes modernes est-il est vrai le plus pauvre qui ait jamais été lorsqu’il s’agit d’estimer un tempérament créateur. Les maquignons de la Finance et des Affaires qui nous dirigent estiment même avantageux de subventionner au début le « copain » politique, qui n’a que la politique pour tremplin, alors que nos maquignons ont la Finance et les Affaires ; Il l’aident donc à grandir, à se hausser à sa première mesure, se disant que ce magnétiseur de foules restera le collaborateur qu’on paie et qu’on casse, au besoin, dès que son utilité n’apparaît plus pour les Finances et les Affaires.
Les conservateurs obstinés ne voient dans Hitler que ce qu’il est capable de préserver dans le désarroi occidental où vit le capitalisme, perpétuellement inquiet et menacé. « Chaque jour suffit à sa besogne » pensent ces gens qui n’ont ni âme, ni rayonnement intellectuel, et qui n’en désirent pas. L’idée, le concept d’un grand caractère leur est aussi étranger que la personnalité du grand artiste ou l’inquiétude de la beauté. C’est ainsi que l’homme peut surgir de ses balbutiements et prendre la direction d’un grand Etat central.
La remilitarisation de la Rhénanie s’effectue alors, l’Anschluss éclate, le monde ne comprend pas. Pourtant, le coup de tonnerre est terrible ! Le copain Mussolini en est, lui-même éberlué. On entend que lors de la remilitarisation de la Rhénanie, le grand état major allemand a tremblé qu’une réaction ne se produise, car l’œuvre militaire était loin d’être au point. Je suis à peu près certain qu’Hitler lui-même a eu la fièvre ; à tort d’ailleurs, puisque le monde qui, encore, pouvait tout, n’a pas bougé – peut-être pour cette raison que le destin est souvent favorable aux grands caractères. Un peu de magnésium a étincelé dans la nuit de l’Europe et de l’Occident, juste le temps de permettre à quelques discours de se produire, à vide ! à quelques phrases d’être photographiées; l’ombre s’est reformée et Hitler a compris davantage qu’il avait raison de ne compter que lui seul et qu’il guidait les événements au lieu de les subir. Alors il a préparé l’acte des Sudètes. Emoi, en cet instant, d’autant plus grand que l’événement est plus « inattendu » (NDLR:relire les journaux de l’époque où sont peintes les successives étapes de la stupeur officielle.) Comme résultat, un scénario exactement pareil au précédent. Il n’y a à chaque fois, qu’un métrage un peu plus long de pellicules ; et Hitler surgit, face au monde, certes, mais face à lui-même ; face à ses avertissements intérieurs qui dès la première heure lui ont laissé entrevoir la route à parcourir. Il prend conscience de son être et « se » comprend de plus en plus. Désormais, les dés sont jetés : à l’Ouest, après de vaines récriminations, on admettra l’inévitable sous la forme de ce qui est fait ; à l’Est, on s’inclinera également. L’histoire de Dantzig peut venir.
On l’a déjà indiqué et cela parait infiniment possible : en face des déclarations de guerre française et anglaise, Hitler n’a pas cru à la sincérité des réactions de ces deux pays. Il a pensé qu’après une parade militaire plus ou moins longue et démonstrative, le besoin d’abdication toujours rencontré, se manifesterait encore, lui permettant de fonder une Allemagne toujours plus puissante, avec le minimum d’inconvénient pour lui, d’abord ; pour son pays, ensuite ; et pour les autres, enfin.
Ici, pourtant, son espoir a été déçu ; un imbécile entêtement surgissant subitement au cœur du camp adverse. Ce furent ces huit mois d’attente guerrière, huit mois d’inaction coupés, seulement, de nouvelles surprises, telle que l’aventure nordique et ingénument avouées à Londres et à Paris. Ces surprises précédèrent la campagne de France et notre total écrasement.
Alors, le souffle de ceux qui aiment encore leur pays, non sans mépriser un peu ceux qui vivent de lui, à bien des échelons !ce souffle s’arrêta. Qu’allait-on faire d’un France abandonnée par tous et par elle. Je me souviens que mon intuition me fit affirmer que l’Allemagne ne réclamerait pas fatalement la déchéance de la France et qu’elle continuerait à considérer comme nécessaire à un équilibre, nouveau, des forces européennes. C’est que l’homme de Mein Kampf était loin ; les triomphes successifs, s’ils affermissaient la position politique d’Hitler, du Chef de parti et du chef de pays voulaient que naisse également et comme conjointement, un propagateur d’idée morale, et qu’Hitler aboutisse au rôle qu’il se fait de lui-même et de la destinée de son pays. Car ce réformateur est un rêveur. Allemand, il l’est et le demeure ; même quand une partie excentrique de son individu l’incite à une propension nouvelle de sa personnalité et l’entraîne où le rêve entrainera toujours l’homme allemand.
Ici, plus que jamais, les deux types, Hitler, Mussolini sont hostiles irréductiblement, comme au Louvre la sculpture romaine s’oppose aux œuvre de la Grèce. Du côté latin de la galerie antique c’est l’humanité terre à terre, puissance politique certaine, mais un peu sèche autant qu’étroite ; du côté grec c’est l’humanité allant jusqu’au divin et l’englobant en soi. D’un côté donc, une humanité trouvant sa fin en soi, et limitant son génie à l’organisation de ce principe sur terre ; de l’autre une tendance méditative qui n’a qu’un pas à faire pour découvrir, sur le chemin de sa splendide raison, l’adjonction mystique qui donnera Orphée ou Pythagore, ou Plotin et ce culte des Idées pures, parti d’un instinct vital, qui à l’origine, contient toute la vie possible. Or, ce don de divination de la vie essentielle, le germain en est étrangement pourvu, et s’il ne l’éclaire pas de « raison » comme le Grec aimait à le faire, du moins, pour lui , comme pour le méditerranéen pur, chaque chose commence-t-elle par un enthousiasme dionysiaque, et ce n’est pas sans raison profonde que Nietzsche a pénétré si intensément cette partie du génie grec, et a noté la liaison de ce penchant avec la musique. Le point de départ chez les deux types est identique puisqu’ils adossent toute vie future à un enthousiasme initial qui va permettre à la vie de rayonner. Chez le Grec, elle rayonne jusqu’à la limite qu’il trouve ou s’assigne ; chez le Germain, elle gravite volontiers jusqu’à l’illimité, et c’est là son danger. Mais là- base est la même et peut se définir ainsi : une exaltation qu’on transporte avec soi et qui agrandit, de champ en champ, de renouvellement en renouvellement, la possibilité éthique, morale ou politique.
C’est cette faculté fécondante qu’Hitler extériorise et c’est à elle que nous devons l’apparition, dans ses préoccupations de l’idée d’un homme européen, à présent que la position de l’homme allemand est établie. Il faut à son dynamisme un élément nouveau à féconder et sa victoire a pour conséquence de le placer en face d’une responsabilité que le rêveur qui écrivit Mein Kampf, le chef de parti, l’homme politique n’avait pas envisagée, et que, si l’un ou l’autre de ces hommes dépassés l’avait évoquée, la raison raisonnante, alors limitée par la proximité des circonstances, l’aurait repoussée, la jugeant incompatible avec l’état de l’œuvre, momentanément présente et possible.
Chose étrange, et, fait, peut-être, nouveau dans l’histoire du monde, ce sont les dimensions de sa victoire qui vont peut-être permettre au rêveur d’assouvir cette passion humaine, d’abord limitée à des créations relativement restreintes, mais qui ne cessent de s’amplifier au fur et à mesure que le succès les fortifie.
C’est qu’il est impossible à chaque homme qui a pensé fortement l’existence de ne pas sentir surgir en lui, venues de profondeurs de son être, le besoin de répandre cette notion de la vie que le rêve lui apporte, en quelque sorte composée. C’est le fait de l’imagination sortant de ses premières vapeurs et organisant un monde immédiat qui font que les éléments de son inspiration sont trouvés insuffisants et c’est cette chaleur qui fait craquer les limites, suivant l‘effort de dilatation que l’imagination opère sur elle-même, sur ce qui l’entoure ou ce qu’elle peut atteindre. Ainsi les confins de la satisfaction individuelle sont rapidement débordés et, par ce jeu de l’être sur l’être, s’organise le rayonnement de l’individu autour de soi. C’est l’exercice de cet « impérialisme du moi » qui constituait pour le Baron Seillières le centre de la personnalité romantique ; centre sentant plus que pensant, d’abord ; mais à qui s’ajoute graduellement l’infini des perceptions, pour peu que l’imagination soit suffisamment créatrice.
Pour l’individu romantique, le monde n’existe que sous la forme d’un développement subjectif..Il le découvre au fur et à mesure que l’imagination – et pour dire plus exactement –son imagination – le recrée et c’est ainsi que cet individu est appelé à transporter dans sa notion du monde, un élan messianique dont il est bien difficile de ne pas découvrir l’essence dans la personnalité d’Hitler. Il croira d’autant plus à ce monde qu’il a la nette impression qu’il l’improvise et qu’avant lui, cet univers n’existait pas, sentiment naïf mais il y a fatalement de la candeur dans l’âme du novateur. Il ne créerait pas s’il ne pensait créer.
Si l’œuvre d’Hitler réussit, si rien ne vient la détourner de l’élan qu’il tente de lui communiquer, peut-être l’Histoire dira-t-elle que cette réalisation est la conclusion logique d’un siècle de romantisme social. La révolution française est un fait essentiellement romantique, au point d’être romanesque en certaines de ses parties ! et tout ce siècle, ou ce siècle et demi, n’a été qu’un long et ardent moment de prosélytisme. Ses formes, ou ses tendances : démocratiques, socialistes, communistes, anarchistes, nazistes enfin, sont les divers accidents de ses explosions successives. C’est, essentiellement, le siècle où les faits humains sont notés sous l’angle de la perception subjective, parce que sous celui de la pure imagination. Ce qu’il y avait d’essentiellement méditerranéen dans le monde, se trouble, s’altère au contact de la constante fulgurance que ce siècle nous apporte. Le principe humain y perd quelque peu de sa transparence ordinaire et acquise, et ceci au profit d’une dilatation de son principe –quelque fois hasardeuse. Mais les faits sont tels et si la négation peut, d’un point de vue théorique, présenter de solides avantages à l’esprit, à l’intelligence qui la risque, elle est sans la plus infime influence sur l’écoulement des choses. Il n’est pas un artiste qui n’ait senti naître un total enthousiasme en assistant au passage du « moi » personnel à l’impression cosmique ; pas un qui, en face de son propre spectacle, n’ait été son propre orateur ou chanteur. Mais l’artiste trouve dans son œuvre un assouvissement à peu près immédiat. Lorsque sa personnalité créatrice s’est absolument accomplie dans l’œuvre créée, il s’établit un rapport entre le « mouvement » de sa personne et la stabilité de l’objet enfanté et ce rapport peut devenir à certains moments, la source d’un apaisement au moins momentané. C’est que l’idée initiale a trouvé en même temps qu’une « étendue » une résistance dans la matière où elle va s’incorporer. Du mélange de matière et d’idée naît une plasticité dont l’intensité, le degré de perfection est l’indice de la puissance créatrice de l’artiste. C’est par la création de cette plasticité qu’il convient de juger un artiste, puisqu’elle constitue la preuve de la réussite plus ou moins obtenue. Chez un artiste, le point de départ se nommera : rêve et la plasticité finale sera son acte. Tout entre ces deux points n’est qu’évolution. Nous pourrions dire de l’œuvre d’art : une chose, née du rêve, attend sa forme définitive. Lorsque l’acte plastique la lui a donnée, l’acte est accompli, à tous ses étages, à tous ses stades. Mais le rôle du rêve dans l’élaboration et l’accomplissement de l’acte peut-être constant ou rester limité par l’intervention d’autres facteurs. Il semble que chez Hitler, le rôle du rêve soit prédominant, et, toujours le parallèle vaut entre lui et Mussolini.
La nature latine tient trop compte de l’aboutissement du rêve en actes pensés, et pensée presque depuis l’originel !- pour laisser intervenir dans l’une de ses créations l’élément musical qui est l’indice de la constance du rêve. Le tempérament de Mussolini se prive ainsi d’une participation susceptible d’enchanter, qui assiste à l’élaboration de l’acte créateur et de maintenir également le créateur dans un état de permanente effervescence. Chez lui la part de réflexion atténue à un tel degré la puissance intuitive que celle-ci sentant l’obstacle, se méfie et avorte. Elle devient raison avant d’avoir achevé son évolution en tant que langage intuitif. Et cette intervention prématurée est la cause, peut-être, pour laquelle nous ne voyons pas la volonté mussolinienne créer des événements « imprévus »tels que ceux qui apparaissent chez Hitler. La politique d’un des dictateurs est d’essence classique, ses tonitruances restent verbales, celle de l’autre est romantique et engendre ce surprenant qui provoque par instant la stupeur. Dans l’un des deux hommes, l’imagination se limite ou se trouve limitée, elle est chez l’autre débordante et ne cesse de s’amplifier alors même qu’elle s’accomplit.
Toujours en ce domaine, il est bon de revenir aux formes de tempéraments : les actes d’Hitler naissent des richesses de l’âme et découvrent leurs sujets d’accomplissement dans une aspiration fulgurante, ceux de Mussolini redoutent cette extension vers l’infini. Il est bon de noter également que le tempérament des deux dictateurs est la très exacte expression de celui de leur peuple. La « mesure » mussolinienne, en dépit de ses outrances verbales, a certainement trouvé, -au moins jusqu’aux désastres de la campagne en Grèce – une approbation profonde dans la masse italienne ; le côté grave et quasi religieux qu’Hitler assigne aux destins de l’Allemagne moderne, cet enseignement aryen et cet acte de même nature qu’il lui réserve atteint au plus profond de son être la masse allemande qui entrevoit ainsi la « mission » dont ses besoins d’âme réclament la présence. Il n’est pas impossible qu’elle lie la notion de l’homme allemand à celle de l’individu européen et lui cherche dans sa langue et dans son propre caractère les définitions de son être.
Dès lors, le langage adopté par le chancelier Hitler ne doit pas nous surprendre, de même que nous n’avons pas de raison valable de douter de la sincérité de ses affirmations. L’homme s’adapte aux dimensions de la plasticité que la concordance de l’inspiration et de l’événement lui propose. Naziste, d’abord, il réalise strictement cette étendue avec l’étroitesse de vue que les limites lui partisan lui imposent. Chef du Reich et Homme d’Etat, il recueille et propage l’impulsion né de cet accroissement et réalise comme récente étendue, cette Allemagne actuelle, lui donnant sa province autrichienne et affirmant la grandeur de l’unité retrouvée, ou créée, qu’il oppose avec infiniment de vraisemblance, au chaos tchéco slovaque. La même nécessité de parfaire son étendu, momentanée, le conduit à Dantzig.
Si, en France et en Angleterre, de vrais hommes d’état eussent pensé la vie européenne, sans doute auraient-ils estimé inutile, en cet instant du développement de la puissance allemande, de tenter de briser cette nouvelle extension, en somme logique, du rêve hitlérien, puisque rien n’avait été essayé auparavant. Ils auraient compris que les fautes accumulées depuis vingt ans, mais surtout depuis dix ans, les rendaient en quelque sorte solidaire de ces réalisations imprévues. N’ayant rien su prévoir ni empêcher à temps, leur simple raison eût du leur dicter la pensée d’un compromis liquidant les fautes commises et leur permettant, en quelque sorte de faire au feu sa part, en rêvant l’avenir.
Hélas, ce fut l’arrêt du Destin de pourvoir la France et l’Angleterre d’hommes politiques n’étant ni des rêveurs, ni de solistes réalistes, mais des personnalités étriquées portées au pouvoir suprême par le hasard de la combinaison électorale, à moins que, comme pour Eden, ce fut la relation mondaine qui fut responsable d’une telle présence.
Le résultat est que possible unité européenne s’est écroulée une fois dans le sang et l’imprévision dont nos malingres potentats ont fait preuve, a voulu que nous assistions à l’apparition d’un nouveau fait encore inattendu : la jonction des deux positions idéologiques ennemies : le nazisme et le soviétisme.
A la veille des hostilités, nous observons avec surprise – toujours !- que Staline se débarrasse du chevelu et verbeux Litvinoff pour lui donner Molotov comme successeur.
Par notre faute, un renversement, non pas des alliances, mais de positions tacitement adoptées depuis dix ans de part et d’autre (états occidentaux et empire russe) veut donc que l’ours russe cesse d’être à l’Est, le chien de garde des intérêts capitalistes ou le gardien des brebis prolétariennes.
Il est probable que la nécessité de ce renversement, a dû en dépit du triomphe diplomatique qu’il représentait, retentir douloureusement dans la conscience d’Hitler, comme il n’a pas manqué, malgré leur discipline, de désorienter les membres du Parti, l’étonnement d’ailleurs n’étant pas moindre au pays de la faucille et du marteau. Mais c’est le privilège des grands stratèges de la politique de n’avoir d’autres scrupules que ceux qu’exige la réalisation de l’œuvre envisagée. A partir de ce renversement, l’œuvre pouvait se présenter à l’esprit d’Hitler sous un aspect qu’il n’avait pas envisagé, mais qui, dans un certain sens, était inespéré.
L’Allemagne possédant l’Europe depuis le Cap Nord jusqu’à Gibraltar, sa position se révélait formidable. Peut-être au Sud et en raison des défaites italiennes, son empire était-il moins assuré. Il ne faut pas cependant oublier qu’en écrasant la France, elle avait évincé de la Méditerranée, le seul grand adversaire qu’elle eut à redouter dans ces parages. Elle y restait seule encore en face de son unique ennemi, l’Angleterre. D’ailleurs sa politique poussait de hardies pointes dans les Balkans, où elle savait que, le moment venu, il lui serait sans doute possible et relativement aisé de provoquer d’autres écroulements en face d’un ordre de puissance qui n’opposait à sa gigantesque organisation militaire que des forces financières doublées d’armées insuffisantes. Un coup d’épaule défonça le dispositif adverse procurant à l’Allemagne la « possession » de la Roumanie, de la Hongrie, de la Bulgarie, de la Serbie, de la Grèce tandis qu’une réaction turque était neutralisée. Dès lors il n’est pas surprenant que l’idée du continent « à faire » , économiquement, politiquement, mais, aussi dirai-je : idéalement se soit, de plus en plus imposée à l’esprit du rêveur Hitler. Trouvant, dans cette plasticité sans cesse étendue l’espace où ce rêve peut étaler les chimères que la volonté transforme en réalité. Fédérer des états voisins, depuis longtemps associer à une œuvre commune, dont le degré de civilisation est à peu près équivalent - états qui ne peuvent attendre qu’une circonstance pour mêler leur intimité nationale au point d’en faire la condition favorable d’un climat à peu près identique, ce point de vue peut tenter un intuitif, c'est-à-dire : un homme en avance sur l’événement, un homme qui, comme l’artiste, part du chaos pour aboutir à l’œuvre. Mais quelle disposition essentielle, doit être requise pour l’accomplissement d’un tel rêve ? Un renversement, non plus des alliances, système désormais désuet ! - mais bien des antagonismes ; prouver que la victoire militaire ne fait que devancer en la préparant l’entente profonde entre peuples vainqueurs et vaincus. Il faut faire de l’acte guerrier actuel ce que toutes les guerres religieuses ou idéologiques ont vainement tenté jusqu’ici : rallier les uns et les autres au nom d’un idéal dépassant les perspectives de la guerre et justifiant les horreurs de celle-ci par la vision de l’avenir qu’elle laisse entrevoir, si toutes les bonnes volontés sont rassemblées. Rêve ? Il se peut encore. Cependant, ce rêve a été pensé par les meilleurs des hommes de ce continent, et comme il existe au fond de tout rêveur un réaliste qui sommeille, Hitler n’ignore pas de quelle puissance magique le mot « Europe » peut jouir auprès de nombreux esprits comme il n’ignore point que l’hostilité principale à la réalisation de ce rêve est venu, non pas d’un antagonisme foncier et irréductible entre les divers tempéraments des nationalités européennes, mais d’un intérêt matériel puissant, extérieur à l’Europe, mais intéressé à sa division :la matière première indispensable à sa fonction industrielle. Nous ne devons jamais perdre de vue que nous nous trouvons en présence d’une Europe dont les populations sont denses – si on les compare aux autres espaces (sauf le Japon) mais dont le sol et le sous-sol (la Russie exceptée) sont pauvres. L’esprit bute contre cette réalité. Seules, les ressources russes peuvent compenser notre déficience.
Or, jamais ces ressources n’ont été largement exploitées, c'est-à-dire de façon à faire du sol et du sous sol russe, le magasin d’approvisionnement du continent tout entier.
C’est que la Russie soviétique se trouvait elle-même devant un dilemme qui ne devait pas manquer d’impressionner ses dirigeants.
Faire profiter l’Europe de ses ressources, c’était ouvrir grandes les portes du « paradis » soviétique, et, peut-être en laisser percevoir les insuffisances profondes. C’était risquer de perdre ce rayonnement dont le mystère de son organisation lui permettait de jouir auprès des masses ouvrières européennes et communistes ou sympathisantes.
C’était de plus établir un contact entre la vie intérieure russe demeurée primitive et une forme d’existence plus évoluée et tuer, dans son essence, le mysticisme particulariste russe et soviétique. C’était en effet laisser voir l’opposition existant entre les théories politiques et la réalité, la première soutenant que la condition prolétarienne n’était obtenue qu’en Russie et qu’ailleurs, il n’existait pour cette classe- affirmation justifiant la tension révolutionnaire imposée au peuple russe !- ni début d’aisance, ni moyens de transport équivalents, ni usine aussi perfectionnée, mais au contraire, une existence soumise à toutes les formes de la contrainte capitaliste. C’était encore appeler chez soi les techniciens étrangers mais, pour cette mise en valeur du sol et du sous-sol, c’était y introduire l’agent capitaliste. C’était, suprême et définitif argument, faire profiter ce système décrié des formidables avantages que l’exploitation des richesses n’auraient pas manqué de produire et, ainsi, fortifier, pour une durée imprévisible ce qu’on s’était engagé précisément à détruire…Enfin, les expériences révolutionnaires faites ailleurs qu’en Russie, au cours de ces vingt dernières années n’avaient pas été des réussites pour le bolchévisme puisque ni en Allemagne, ni en Bavière, ni en Hongrie, en dépit de circonstances favorables, ni en Italie, ni en Espagne, le mouvement n(avait vraiment pu s’enraciner. Ces échecs successifs et constants semblaient prouver que hors de ses frontières, le bolchévisme se heurtait à des conditions psychologiques qui lui étaient nettement défavorables au point qu’on pouvait penser qu’il devenait un élément de consommation intérieure et pour races attardées. Or, le bolchevisme se heurtait sait qu’elle est la condition essentielle de son triomphe. S’il a remis sur les derniers rayons de sa bibliothèque pas mal de se principes premiers, au moins en est-il un qu’il n’a pas oublié : cette affirmation d’ailleurs judicieuse de Lénine déclarant que la révolution ne peut-être que mondiale.
Ces raisons peuvent expliquer ce circuit fermé que constituerait l’économie russe et le refus des dirigeants de puiser dans les ressources du sol russe ou sibérien pour d’autres besoins que les leurs. La guerre est survenue, surprenant ce « moule à part » dans cet état d’expectative.
Il faut croire que, plus lucide que la plupart de nos hommes d’Etat, Staline avait perçu le gigantesque de la puissance allemande. Il jugea bon – et peut-être prudent, d’établir un accord avec elle, estimant qu’après une campagne avec la France et l’Angleterre, la puissance allemande accuserait une lassitude rendant, en ce qui le concernait, l’obstacle moins insurmontable. Le moment était venu pour le monde russe de voir les puissances à l’œuvre et de juger de leur résistance. Son état major, ses techniciens auront entre temps, profité des expériences faites par les autres et avec leur sang et leurs tactiques diverses. Un Occident ruiné par la guerre, un Centre Européen épuisé par son assaut contre les forces de l’Ouest, l’heure d’une bolchévisation générale n’aurait-elle pas sonné ? Seulement, à la surprise du monde entier l’armée française s’est effritée en quelques semaines et, peut on dire dès le premier coup porté ; au contraire, celle de l’Allemagne est sortie non seulement intacte de la victoire remportée mais avec une assurance morale décuplée ;
Restait l’Angleterre. Soumise au bombardement terrible, elle tient, prouvant ainsi qu’encore, l’avion ni la bombe ne constituent un élément décisif. Mais si l’Angleterre résiste, elle est incapable de faire plus. Comme une place assiégée dont la garnison est insuffisante pour la défense des remparts mais qui ne saurait se hasarder hors de ses murs. Ce n’est pas avec cette possibilité qu’une décision risque de jamais être obtenue, au moins sur le terrain militaire. L’armée, la jeune armée anglaise, dont les effectifs sont à instruire, dont les cadres doivent être créés et le matériel mis au point, cette armée reste à l’abri de ce rempart qu’est la mer pour elle. Du point de vue russe, cette force est inexistante. Dans ces conditions, tenter une campagne à l’Est serait hasardeux ! Il vaut mieux attendre en achevant les préparatifs.
On dirait parfois que le destin sommeille. De mai 1940 à la campagne balkanique, pas d’événements sensationnels .Puis cette péninsule s’enflamme.
Il est probable que l’anxiété a été grande à Moscou. Convenait-il d’intervenir ? Staline ne paraît pas avoir été le rêveur qui prend ses décisions, alors que les seules lueurs de l’inspiration les lui ont fournies ; il n’a pas bronché, laissant le frère serbe à son destin malheureux et le neveu grec à son écrasement fatal.
Alors, que s’est-il passé dans l’âme d’Hitler ? Si, faire l’Europe nécessite une participation sans réticences de la production, de la capacité russe, pendant ces mois d’hiver et de printemps qui précédèrent la campagne dans les Balkans, il est à présumer que les demandes, les injonctions ont dû souvent se répéter entre Berlin et Moscou. C’est que non seulement les perspectives d’une économie future rendent cette participation désirable, mais les nécessités du combat exigent qu’elle devienne immédiate. A la bataille d’Angleterre s’est substituée l’idée d’une probable bataille de l’Atlantique, bataille pour laquelle, il se peut que les prévisions allemandes aient été prise en défaut. Certes les stocks constitués sont gigantesques et ce ne sont certainement pas les campagnes de Pologne et de France qui les ont épuisés, mais la guerre use malgré tout et sa prolongation et son extension possible rendent nécessaire de faire entrer et par tous les moyens la ressource russe dans le circuit allemand. L’insistance se fait, pendant ces huit mois d’attente, pressante. On cherche à obtenir cette importante décision. On joue, même, plus qu’on ne le désire sur la carte idéologique à tel point qu’on peut dire qu’il est un moment ou le nazisme verse de plus en plus vers sa tendance « masse et socialiste » ceci est nettement perceptible à travers les reflets de la politique française qui cherche son inspiration à Berlin ou à l’ambassade. Il s’agit d’attirer l’ours russe dans son camp et l’on estime que ces inclinations lui rendront l’idée d’une collaboration favorable. Mais l’ours se méfie et fait la sourde oreille.
Moment important pour le rêveur Hitler ! Jusqu’où peut aller l’esprit de conciliation qui deviendrait un esprit de concession ? et jusqu’où le sens des hiérarchies glorifié par Rosenberg et dont tout le régime a fait sa base, peut-il être atténué au profit du confusionnisme marxiste ? Question de conscience autant que de calcul politique !....
D’autant qu’à l’Ouest, tout est incertitude. L’Angleterre tient toujours. ? Chaque blocus agit mais se révèle inefficace. La France accomplit une révolution de parade et s’engage dans une collaboration larvée. Et, cependant, l’Europe est bien devenue une plus vivante réalité depuis la victoire allemande ; le rêveur en sent la plasticité sous ses doigts. Une Europe est certaine ; elle n’est plus seulement possible, mais l’ours voisin ne paraît pas vouloir comprendre ni, même partager le désir d’envol de l’aigle allemand. Renfrogné, il se terre se demandant sans doute si, dans cette Eurasie dont on lui promettait le parfum et dont il est, géographiquement le centre, la domination viendra de Moscou ou de Berlin. Il est assez puisant pour ne pas devenir le satellite, même d’une force considérable. Certes, les donnes politiques, allemande, russes ont des points de ressemblance avec d’autres : hiérarchie des intérêts, des individus, des races, elles sont nettement antagonistes. L’ours attend tandis qu’Hitler s’impatiente.
Un simple logicien tel que Mussolini lâcherait un peu, même beaucoup de sa doctrine – étant plus près de Machiavel que de Nietzche, mais encore ici l’opposition des tempéraments apparaît. Chez Hitler, une avance trop forte faite du côté bolchévique signifie une négation de la valeur morale qu’il veut représenter et le moral l’emporte sur le politique.
L’avenir nous dira qui a eu raison.
Donc, ces matières indispensables d’abord à la lutte sur l’Atlantique et à la constitution d’un continent européen indépendant de la matière première anglo-saxonne, ces matières qui n’ont pas voulu docilement venir à lui, Hitler ira les chercher là où elles ont ; c’est la guerre avec la Russie.
D’abord je n’ai pas compris la réalité cachée de ce nouveau conflit. Pendant l’hiver et une partie du printemps 41, j’ai cru à une possible collaboration groupant la France – vaincue mais encore à) la tête de la majeure partie de son Empire – l’Espagne subjuguée, l’Italie harassée mais fatalement enchaînée à une Allemagne dilatée jusqu’à la Belgique, la Hollande, la Scandinavie et possédant la totalité du centre européen. En ce même instant, les plus … mes de chez nous mais accréditées par l’Ambassade vantaient une collaboration que la raison estime inévitable et qui avait l’avantage de dessiner un premier aspect de l’Europe « européenne ». Il semblait alors assez logique que la Russie oscillât vers ce groupe où les antagonismes doctrinaires sont moins grands que de l’autre côté. Dans cette unité créée l’Europe risquait de retrouver le sens de sa mission civilisatrice, perdue au moins depuis cent ans. Le continent pouvait se soustraire à l’influence dévastatrice pour ses valeurs spirituelles profondes, américaine.
Peut-être cette constitution aurait trouvé sa juste répercussion outre Atlantique en faisant perdre à ce continent le rôle de pourvoyeur obligatoire qu’il a cru devoir s’assigner dans la répartition des marchandises consommées. Elle aurait peut-être enfin fait naître dans ces peuples jeunes mais essentiellement barbares, un sentiment qu’ils semblent n’éprouver jamais, celui de l’inquiétude intérieure et des vrais tourments moraux. Elle eût en tout cas rétabli une sorte de prééminence de la fonction européenne dont il semble que la race blanche – et les autres aussi, ne puisent encore se passer.
Maxime NEMO le 7 novembre 1941.








 Si bien que, menant pendant un temps une vie extrêmement brillante au milieu des artistes au besoin en renom, finalement nous tombions dans une sorte de solitude où naturellement nul ne venait nous chercher. Alors, mon père quittait Paris, subitement, juste après avoir noué des relations utiles et s’enfuyait en Bretagne, dans un coin sauvage, ou au fin fond des Pyrénées, en plein hiver. Dans cette solitude, il changeait d’allure comme de vie. Les costumes commandés chez le bon faiseur étaient enfouis dans une malle quelconque, en attendant d’être vendus pour des sommes dérisoires ! Il se vêtait de bure, de velours à côtés, lisait éperdument et ne faisait rien. En dehors de la formation littéraire à laquelle j’étais quotidiennement soumis, j’étais libre ; faisant absolument ce que je voulais. Ma seule compagnie était un setter blanc et noir, témoin de mes promenades quotidiennes. Je sais que dans cet hiver passé au fond des gorges de
Si bien que, menant pendant un temps une vie extrêmement brillante au milieu des artistes au besoin en renom, finalement nous tombions dans une sorte de solitude où naturellement nul ne venait nous chercher. Alors, mon père quittait Paris, subitement, juste après avoir noué des relations utiles et s’enfuyait en Bretagne, dans un coin sauvage, ou au fin fond des Pyrénées, en plein hiver. Dans cette solitude, il changeait d’allure comme de vie. Les costumes commandés chez le bon faiseur étaient enfouis dans une malle quelconque, en attendant d’être vendus pour des sommes dérisoires ! Il se vêtait de bure, de velours à côtés, lisait éperdument et ne faisait rien. En dehors de la formation littéraire à laquelle j’étais quotidiennement soumis, j’étais libre ; faisant absolument ce que je voulais. Ma seule compagnie était un setter blanc et noir, témoin de mes promenades quotidiennes. Je sais que dans cet hiver passé au fond des gorges de 
 Cet homme, dont le visage extrêmement doux me frappa, donna ce conseil à mon père :
Cet homme, dont le visage extrêmement doux me frappa, donna ce conseil à mon père : Je me souviens avoir à Saint Sauveur, au fond des Pyrénées, dans ce village de saison estivale où trois habitants composaient la population hivernale – si bien que cette population fut doublée par notre arrivée en ce lieu perdu ! – je me souviens avoir garni ma chambre de buis de toutes teintes ; ils croissaient à profusion sur les pentes environnantes. J’en cueillais de rouges, de jaunes et, naturellement, de verts. Je tentai de sauver un faucon blessé que j’avais trouvé dans les bois et qui vécut huit jours à côté de mon lit. J’apprivoisai deux tourterelles des bois qui devinrent à ce point familières que je sortis avec elles, chacune en liberté se tenant sur ma main. Lorsque l’une s’envolait, il suffisait que je l’appelle d’une certaine façon pour qu’elle quitte aussitôt la branche où elle était montée et reprenne ce qui ne m’empêcha pas, lorsque les fruits mûrirent, d’aller chercher des fraises sauvages dans les terrains schisteux où l’eau des neiges coulait encore mais où les vipères abondaient. Ma sensibilité se hérissait lorsque, non loin, j’apercevais le rampement du corps rond moucheté de brun du reptile dangereux. Je frissonnais autant lorsqu’il s’agissait d’une simple couleuvre. Même je crois que ma répulsion était proportionnée à la longueur de la bête et que certains de ces corps jaunes et gris, se retirant en faisant bruire légèrement les herbes, ont fait battre mon cœur et arrêté la respiration plus qu’à la proximité des reptiles venimeux.
Je me souviens avoir à Saint Sauveur, au fond des Pyrénées, dans ce village de saison estivale où trois habitants composaient la population hivernale – si bien que cette population fut doublée par notre arrivée en ce lieu perdu ! – je me souviens avoir garni ma chambre de buis de toutes teintes ; ils croissaient à profusion sur les pentes environnantes. J’en cueillais de rouges, de jaunes et, naturellement, de verts. Je tentai de sauver un faucon blessé que j’avais trouvé dans les bois et qui vécut huit jours à côté de mon lit. J’apprivoisai deux tourterelles des bois qui devinrent à ce point familières que je sortis avec elles, chacune en liberté se tenant sur ma main. Lorsque l’une s’envolait, il suffisait que je l’appelle d’une certaine façon pour qu’elle quitte aussitôt la branche où elle était montée et reprenne ce qui ne m’empêcha pas, lorsque les fruits mûrirent, d’aller chercher des fraises sauvages dans les terrains schisteux où l’eau des neiges coulait encore mais où les vipères abondaient. Ma sensibilité se hérissait lorsque, non loin, j’apercevais le rampement du corps rond moucheté de brun du reptile dangereux. Je frissonnais autant lorsqu’il s’agissait d’une simple couleuvre. Même je crois que ma répulsion était proportionnée à la longueur de la bête et que certains de ces corps jaunes et gris, se retirant en faisant bruire légèrement les herbes, ont fait battre mon cœur et arrêté la respiration plus qu’à la proximité des reptiles venimeux. 





 Alors, le livre de Cyrano dans mon cartable, je filais sous les arbres ou vers les rues aux murs de terre du village nègre, et là, assis, sous un arbre, j’ânonnais, je lisais, apprenais. Je sus le IVè acte d’abord ; tous les rôles, pleurant pour Roxane et pour Cyrano ; très peu pour Christian qui me paraissait un peu bête de ne pas savoir parler aux femmes. Ce fut décisif. Lorsque je n’avais plus le livre, , je récitais les passages que je savais par cœur. Je me les disais à moi seul ou aux amis que je m’étais faits parmi les Bat d’Aff. Je les avais trouvés sur les chemins qu’ils devaient empierrer au moins théoriquement. Sur des tas de pierrailles, on avait causé. Lorsque je me mis à leur dire des vers – il me fallait tout de même un auditoire, et les nègres et les arabes de ma classe étaient ineptes – ce fut magique ; je devins l’Adopté ; ils savaient mon prénom, et du plus loin que j’apparaissais, m’appelaient. J’avais des kyrielles de militaires dans ma famille, j’aimais jusqu’à l’odeur de la caserne et du soldat suant. Les Bat-D’Aff étaient des types épatants et des auditeurs nés ; Nous passions de longs moments, jusqu’à l’heure de rentrer dans ma maison. D’ailleurs cette heure était incertaine, mon père et ma mère passant leur temps au Casino ou chez des amis, il n’y avait au domicile que le domestique arabe, Sadock et une femme de chambre maltaise qui n’était jamais là. Pour rien au monde ces deux êtres ne m’eussent dénoncé.
Alors, le livre de Cyrano dans mon cartable, je filais sous les arbres ou vers les rues aux murs de terre du village nègre, et là, assis, sous un arbre, j’ânonnais, je lisais, apprenais. Je sus le IVè acte d’abord ; tous les rôles, pleurant pour Roxane et pour Cyrano ; très peu pour Christian qui me paraissait un peu bête de ne pas savoir parler aux femmes. Ce fut décisif. Lorsque je n’avais plus le livre, , je récitais les passages que je savais par cœur. Je me les disais à moi seul ou aux amis que je m’étais faits parmi les Bat d’Aff. Je les avais trouvés sur les chemins qu’ils devaient empierrer au moins théoriquement. Sur des tas de pierrailles, on avait causé. Lorsque je me mis à leur dire des vers – il me fallait tout de même un auditoire, et les nègres et les arabes de ma classe étaient ineptes – ce fut magique ; je devins l’Adopté ; ils savaient mon prénom, et du plus loin que j’apparaissais, m’appelaient. J’avais des kyrielles de militaires dans ma famille, j’aimais jusqu’à l’odeur de la caserne et du soldat suant. Les Bat-D’Aff étaient des types épatants et des auditeurs nés ; Nous passions de longs moments, jusqu’à l’heure de rentrer dans ma maison. D’ailleurs cette heure était incertaine, mon père et ma mère passant leur temps au Casino ou chez des amis, il n’y avait au domicile que le domestique arabe, Sadock et une femme de chambre maltaise qui n’était jamais là. Pour rien au monde ces deux êtres ne m’eussent dénoncé. 





 (mère du réalisateur
(mère du réalisateur 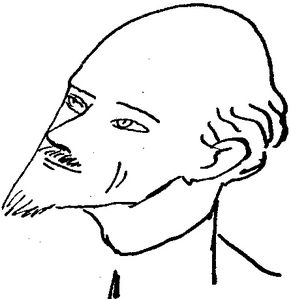 où il relate les 70 spectacles dont une danse macabre du XIVè adaptée par Carlos Larronde.
où il relate les 70 spectacles dont une danse macabre du XIVè adaptée par Carlos Larronde.